Quand la perception enferme, seule la confrontation aux faits libère.
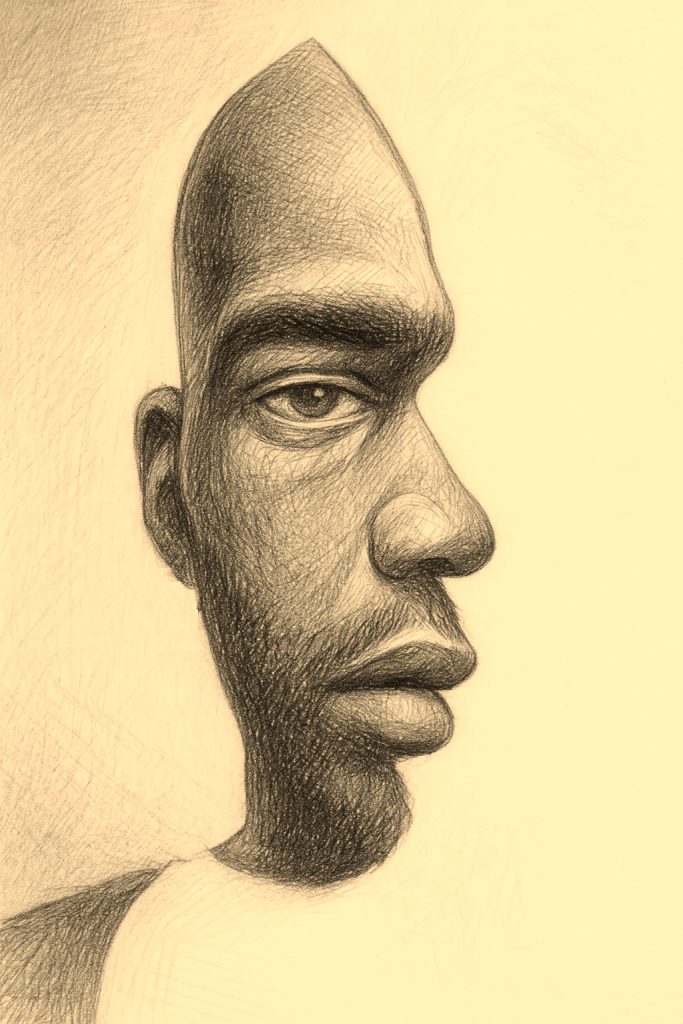
Table des matières
3 Le point aveugle du modèle Bustamante, pourquoi la seule « perspective » ne suffit pas.
4 Le vrai métier d’un agent, c’est la vérité des faits, pas la simple coexistence des récits.
4.1 Attention au piège du relativisme absolu.
4.2 Attention : la réalité partagée n’est pas toujours la réalité des faits.
4.3 Un paradoxe troublant et un biais dangereux.
5 Définition de la perspective à la lumière de la grille Vénoa.
6 Pourquoi la perception de l’EPV est verrouillée ?
7 Perception verrouillée: ce n’est pas que pour les « durs » !
8 Pourquoi la perspective est si difficile, pour tous ?
9 La clef pour basculer : reconnaître sa perception et l’honorer… puis ouvrir à l’autre.
10 Pour les enfants/adolescents, pourquoi c’est si difficile à la maison ?
11 L’apport du modèle Vénoa (EPS/EPV) : aller plus loin que le simple conseil
12 Pourquoi Bustamante passe-t-il sous silence la confrontation aux faits ?
13 Distinguer perception, perspective et faits.
14 La perception : un héritage ancien.
14.1 Antonio Damasio : quand l’émotion guide la perception.
15 Conclusion, s’ouvrir à la perspective, c’est un chemin de guérison mutuelle.
V03-08/25
1 Introduction
Dans la vie de famille, à l’école ou en couple, on se retrouve souvent à tourner en rond : chacun campe sur sa version, les disputes s’enveniment, et personne ne se sent compris. Andrew Bustamante, ancien agent de la CIA, explique ce phénomène par la différence entre perception et perspective. En allant plus loin, on voit que la dynamique cachée derrière ces mots éclaire aussi nos blessures les plus profondes.
2 Définition rapide
- Perception : Ma façon de voir le monde, mes filtres, mes blessures, mon histoire. Ce que je ressens est vrai pour moi. (Mais ce n’est pas forcément la réalité). La Perception c’est la réalité intérieure (ou ma réalité intérieure), ma façon singulière de ressentir et d’interpréter le monde. Elle est unique, forgée par mon histoire, mes émotions, mes blessures. La perception est indispensable pour comprendre ce que je vis, mais elle n’est jamais la réalité toute entière.
- Perspective : L’élargissement de mon regard : je prends en compte la vision de l’autre, j’ouvre mon écoute, je suspends mon jugement. Je ne cherche plus à avoir raison, mais à comprendre ce que l’autre vit.
Je prends en considération les deux perceptions ce qui donne de la perspective.
3 Le point aveugle du modèle Bustamante, pourquoi la seule « perspective » ne suffit pas.
Etonnamment, alors qu’il a été formé à la CIA à la confrontation aux faits, Bustamante évite cet enjeu majeur dans son discours public. Bustamante suggère qu’il suffit d’ouvrir son regard, de travailler sur sa perception, pour que la relation devienne plus fluide et harmonieuse. C’est séduisant, mais profondément incomplet.
La perspective ou recul est profondément nécessaire, dans un monde idéal si chacun était honnête et conscient de la portée et de la valeur de ses mots, cela fonctionnerait parfaitement. Si le déni et les verrous existentiels n’existaient pas.
En réalité,
- Si une personne manipule la réalité, réécrit les faits, nie ce qui s’est passé ou inverse la faute (déni, gaslighting, distorsion…), aucune ouverture d’esprit, aucune perspective ne permet de s’aligner sur une vérité commune.
- Travailler uniquement sur sa perception ne change rien quand l’autre refuse (consciemment ou non) d’affronter la réalité. Si la personne vit dans le déni, il n’est pas nécessaire d’évoquer des procès historiques comme celui de Nuremberg : ces situattions sont quotidienes et nombreuses. Face au déni, on reste dans un dialogue de sourds, ou pire, dans une relation de domination psychique.
C’est là que la grille Vénoa apporte un complément décisif :
- Elle identifie ce verrouillage du rapport aux faits comme un mécanisme de défense inconscient, souvent lié à une blessure profonde, qui pousse l’EPV à protéger coûte que coûte son image et son ressenti, au prix de la réalité.
- Elle montre que la perspective authentique n’est possible que si les deux acceptent de confronter leur perception à la réalité des faits, dans un espace sécurisé.
- Sinon, toute la démarche reste factice : le plus sensible (EPS) risque de se faire écraser ou manipuler, et le verrouillé (EPV) renforce son déni.
- Travailler sa perspective est nécessaire, mais jamais suffisant.
- Quand l’autre nie la réalité, manipule ou réécrit l’histoire, la seule issue saine est de poser une limite claire, reconnaître l’impasse, et parfois protéger sa propre intégrité psychique.
Dans 70 à 80 % des cas, la perspective authentique reste inatteignable, parce qu’un verrou émotionnel inconscient verrouille l’accès à la remise en question des faits, peu importe les efforts de dialogue ou d’ouverture.
Pour les 20 à 30 % restants (les plus sensibles ou ouverts), la perspective peut vite devenir un piège : à force de vouloir tout remettre en question, de douter de soi, de vouloir « comprendre l’autre à tout prix », ils risquent de se perdre eux-mêmes, de nier la réalité des faits, et de finir… du côté de celui qui manipule ou tord la réalité (par inversion accusatoire, gaslighting, complotisme, projection, etc.).
En clair :
La perception seule ne suffit pas dans la grande majorité des cas, car le verrou émotionnel bloque tout ajustement réel.
La perspective non adossée à la réalité des faits expose les plus sensibles à la confusion, à la soumission, et au doute pathologique.
Conclusion :
La seule « bonne volonté » ne suffit pas. Il faut un ancrage dans la réalité, la capacité à nommer la manipulation, et la légitimité de poser des limites, sinon, le discours de la perspective peut se retourner contre les plus ouverts, au profit de ceux qui verrouillent ou manipulent la vérité.
4 Le vrai métier d’un agent, c’est la vérité des faits, pas la simple coexistence des récits.
4.1 Attention au piège du relativisme absolu
Une dérive de plus en plus répandue dans la société et les discours de développement personnel consiste à affirmer que « chacun crée sa propre réalité ».
Si cette idée peut être libératrice à petite échelle – pour se réapproprier sa vie intérieure – elle devient dangereuse dès qu’on la rend absolue :
– Elle justifie aussi bien la violence (je n’ai fait qu’agir selon ma réalité) que la soumission (ce que je subis, c’est ma réalité, donc je dois l’accepter).
– Elle efface le socle commun du réel : il n’y a plus de justice possible, ni plus de reconnaissance de la souffrance de l’autre, ni plus de recours.
– L’histoire humaine regorge de tragédies fondées sur ce biais. Pogroms, persécutions, dénis collectifs : l’Allemagne nazie en est un exemple extrême. Une réalité partagée a prévalu, niant les faits de la douleur et de la violence faite à autrui..
C’est pourquoi la perspective authentique doit toujours être reliée à la réalité partagée : ce qui s’est réellement passé, ce qui est constatable, ce qui peut être reconnu par d’autres, et les faits.
Sinon, la perspective devient un piège pour les plus vulnérables et un blanc-seing pour les manipulateurs.
4.2 Attention : la réalité partagée n’est pas toujours la réalité des faits
Bustamante parle d’enrichir les deux visions et de partager chaque perception dans un objectif de perspective.
Beaucoup de discours modernes parlent de « réalité partagée », ce que le groupe, la société, ou la majorité reconnaît comme vrai à un instant donné.
Mais cette « réalité partagée » peut, elle aussi, être fausse, biaisée, ou manipulée.
De nombreux discours amènent aussi à dire que « chacun crée sa propre réalité » tout comme le film Matrix le projette.
Quand ce relativisme se radicalise, il devient le carburant de toutes les dérives collectives, qu’elles soient violentes (pogroms, exclusions, fanatismes…) ou passives (soumission à l’injustice, auto-annihilation de la victime, acceptation de l’inacceptable).
Pourquoi c’est dangereux ?
- Si la réalité n’existe que dans ma tête, alors tout devient justifiable : la violence que j’exerce (« c’était ma réalité, j’ai agi en conscience, je fais justice, je venge, j’assassine par justice etc… »), comme celle que je subis (« c’était ma réalité, je dois l’accepter, je n’ai rien à dire, je suis la pour subir, mon destin c’est d’être martyre ou sacrifiée »).
- Il n’y a plus de recours commun, plus de justice possible : la réalité extérieure, partagée, devient un terrain vague où tout s’efface au profit de « la vision de chacun ».
- Le socle de l’empathie disparaît : si je ne reconnais pas la réalité de la souffrance de l’autre, je peux la nier ou la justifier par mon propre système de croyances.
- Historiquement, ce mécanisme a permis toutes les grandes violences, et aussi le silence, l’impuissance ou l’auto-censure des victimes.
- La « réalité partagée » (ce sur quoi une communauté ou un groupe s’accorde) n’est pas toujours la vérité des faits : elle peut n’être qu’un consensus, un compromis, ou même une illusion collective (« tout le monde y croit, donc c’est vrai » : souvenons-nous de Galilée, condamné pour avoir affirmé que la Terre tourne autour du Soleil, alors que la réalité partagée de l’époque voulait que la Terre soit le centre de l’Univers.
- Les faits sont indépendants des croyances et perceptions : ils existent en dehors de nous, et peuvent parfois contredire la réalité « partagée ».
C’est justement sur ce glissement que naissent tant de dérives : quand une « réalité partagée » (idéologie, déni collectif, croyance majoritaire) efface ou travestit les faits, l’injustice devient possible, et l’histoire regorge d’exemples (procès truqués, dictatures, « consensus » violents…).
Ce qui importe, ce ne sont pas seulement les perceptions individuelles ou collectives, mais les faits eux-mêmes : ce qui s’est réellement passé, ce qui est objectivement constatable ou prouvable.
L’enjeu n’est donc pas de s’aligner sur une réalité partagée si elle dévie des faits, mais d’avoir le courage de revenir sans cesse à l’examen des faits, même contre le courant dominant ou la pression du groupe.
C’est seulement à partir des faits, et non du consensus ou de la majorité, que la justice, la réparation, ou la vérité peuvent émerger.
Quand la réalité partagée dévie des faits, il faut avoir le courage de s’en tenir à la vérité des faits, même contre la pression du groupe.
Ce glissement du fait vers le consensus ou la croyance majoritaire n’est pas anodin : il explique bien des drames collectifs, et c’est précisément pour l’éviter que tout travail sérieux, en justice, en science, en psychologie, commence par l’établissement des faits.
4.3 Un paradoxe troublant et un biais dangereux
Il est frappant, et même troublant, de constater qu’Andrew Bustamante, en tant qu’ex-agent de la CIA, ne mentionne jamais dans sa vidéo l’importance des faits dans la construction de la perspective.
Or, le cœur du métier d’un agent, policier, magistrat ou enquêteur, c’est justement d’établir les faits, de confronter les perceptions à la réalité objective, et de distinguer ce qui s’est réellement passé de ce que chacun croit avoir vécu.
Passer cela sous silence, c’est induire le public en erreur. La perspective authentique, en intelligence, en justice, en psychologie, repose d’abord sur le travail des faits, non sur la seule écoute des perceptions.
Cela explique pourquoi la perspective, la confrontation aux faits et la reconnaissance du réel extérieur ne sont pas des détails techniques, mais des garanties profondes contre le déni, la manipulation et l’injustice, à la fois pour ne pas devenir bourreau, et pour ne pas rester victime sans recours.
En évacuant la question des faits, la vidéo diffuse un message séduisant mais trompeur, et ce silence est d’autant plus problématique qu’il vient d’un expert qui connaît mieux que quiconque la nécessité vitale de l’ancrage factuel.
5 Définition de la perspective à la lumière de la grille Vénoa
La perspective, dans le sens de la grille Vénoa, n’est pas une posture « zen » ou simplement un effort d’écoute de l’autre.
C’est une démarche active et courageuse qui comprend :
- 1. La reconnaissance de sa propre perception, de ses émotions et blessures (oser dire « je ressens ça », sans travestir ni minimiser, sans accusations).
- 2. L’accueil de la perception de l’autre, même si elle nous déstabilise ou réactive nos propres failles (écoute réelle, pas seulement tolérance).
- 3. La confrontation honnête avec la réalité des faits, accepter de regarder ensemble ce qui s’est réellement passé, ce qui est prouvable, vérifiable ou observable (dates, messages, actions…).
- 4. La capacité à distinguer entre perception, émotion et manipulation, discerner si l’autre (ou soi-même) tente de réécrire l’histoire, d’inverser les rôles, ou de fuir la réalité.
- 5. L’ajustement réciproque : La perspective devient une dynamique vivante où chacun peut réviser sa propre vision à la lumière de l’échange ET des faits, pas seulement pour « faire plaisir » mais pour avancer ensemble vers plus de vérité.
La perspective, ce n’est pas « tout écouter et tout accepter » : c’est avoir le courage de se confronter, d’explorer les divergences, de voir où nos perceptions résistent à la réalité, et de poser des limites quand la vérité est niée.
La perspective selon la grille de lecture EPV/EPS, c’est la capacité à habiter sa propre vérité, à accueillir celle de l’autre, puis à chercher ensemble, dans le respect des faits et des limites, un terrain de rencontre. Quand ce terrain est refusé, il faut avoir la lucidité d’en prendre acte et de se protéger, mettre les limites et ne plus chercher à discuter car le dialogue sera impossible. Cesser de discuter face au verrouillage, ce n’est pas renoncer à la vérité, c’est reconnaître le réel : on ne peut pas dialoguer avec le déni ou la manipulation.
La perspective ne peut être authentique que si elle inclut la reconnaissance des faits, la confrontation au réel, et la lucidité face à la manipulation. Omettre cela, c’est offrir une vision naïve, voire complice, des dynamiques de pouvoir et de souffrance dans les relations humaines. Il ne s’agit pas seulement d’écouter et d’accueillir : il faut aussi avoir le courage de dire non à la falsification de la réalité.
6 Pourquoi la perception de l’EPV est verrouillée ?
La perception du côté EPV (Enfant Perdu Verrouillé) est dite « verrouillée » parce qu’elle est :
1. Rigide et auto-protectrice
- L’EPV s’est construit une perception du monde qui lui permet de ne pas ressentir la douleur d’une blessure ancienne (humiliation, rejet, trahison, etc.).
- Cette perception fonctionne comme une « armure psychique » : elle filtre tout ce qui pourrait réactiver la blessure.
2. Résistante à la remise en question
- Remettre en cause sa perception, pour l’EPV, ce n’est pas simplement changer d’avis : c’est prendre le risque de faire ressurgir une douleur profonde, longtemps enfouie.
- Toute tentative extérieure (dialogue, preuve, confrontation aux faits) est vécue comme une attaque ou un danger existentiel, et déclenche souvent du déni, de la défense, voire de l’agressivité.
3. Ancrée dans un mécanisme inconscient
- Ce verrouillage est inconscient et réflexe : l’EPV ne choisit pas de se fermer, il y est poussé par un mécanisme de survie psychique.
- Il se coupe (ou a été coupé) de ses ressentis les plus vulnérables : pour lui, remettre en question sa perception serait ouvrir la porte à un effondrement psychique (angoisse, honte, perte de l’identité…).
4. Favorise la distorsion de la réalité
- Pour éviter la douleur, l’EPV peut aller jusqu’à réécrire l’histoire, tordre les faits, nier l’évidence, ou inverser la faute (projection, inversion accusatoire, gaslighting…).
- Sa perception n’intègre plus la complexité du réel, mais devient un système de défense fermé.
5. Pourquoi c’est si difficile à faire évoluer ?
- Tant que la blessure d’origine n’est pas reconnue, apaisée ou accompagnée, la remise en question est vécue comme une agression.
- C’est pourquoi, même face à des preuves ou des faits indiscutables, l’EPV maintiendra sa version, quitte à rompre le dialogue ou à accuser l’autre d’être dans l’erreur ou la folie.
En résumé
La perception « verrouillée » de l’EPV est un bouclier inconscient contre la souffrance. Vouloir la « briser » de l’extérieur ne sert à rien, seul un chemin de reconnaissance, de sécurité émotionnelle et d’accueil de la blessure peut, parfois, desserrer ce verrou.
7 Perception verrouillée: ce n‘est pas que pour les « durs » !
« rester enfermé dans sa perception », c’est le lot des personnes fermées, autoritaires, insensibles (ce fameux EPV – 70 à 80% de la planète). C’est vrai… mais pas seulement.
- Un Enfant Perdu Sensible (EPS) peut lui aussi rester figé dans sa perception… celle de sa propre souffrance.
- Quand il a été maltraité, ignoré, ou incompris, il peut s’enfermer dans la certitude (réelle) d’être « le sacrifié »: tout ce qu’il vit repasse par ce filtre.
- Sa douleur devient alors un mur, il n’entend plus vraiment ce que l’autre tente de dire, même si l’autre souffre aussi.
- Il peut alors attendre d’être « vu », « reconnu », « aimé »… sans pouvoir, lui, écouter la blessure de l’autre (par peur de perdre sa propre légitimité).
Exemple concret:
Un enfant qui a été humilié ou exclu à l’école. Même face à un parent qui souffre, il ne peut entendre que ce qui valide sa propre souffrance. Il veut que son vécu soit reconnu avant toute chose. Ce n’est pas du narcissisme, mais un besoin vital de réparation… qui devient, paradoxalement, un enfermement.
8 Pourquoi la perspective est si difficile, pour tous ?
- Pour l’EPV : Le verrouillage se fait sur le mode « je veux avoir raison », « je refuse l’émotion », « la vulnérabilité c’est être faible », « je projette ma douleur sur l’autre ».
- Pour l’EPS blessé : La douleur est telle que tout dialogue ramène à la peur d’être nié. Il n’a pas d’espace pour écouter, il attend d’être réparé.
- Dans les deux cas, chacun est dans sa perception. La perspective demande de reconnaître à la fois ce que je vis… et ce que vit l’autre. C’est un saut énorme, surtout si on n’a jamais été vu, ni entendu enfant.
9 La clef pour basculer : reconnaître sa perception et l’honorer… puis ouvrir à l’autre
Étape 1 : Accueillir ce que je ressens, nommer ma blessure (« je me sens blessé, incompris, rejeté… »).
Étape 2 : Accepter que l’autre a, lui aussi, une perception, peut-être aussi douloureuse, mais différente.
Étape 3 : Tenter, petit à petit, de poser des questions (« Qu’est-ce que tu ressens, toi ? » « Qu’est-ce qui t’a blessé ? »). Parfois, ce n’est pas possible tout de suite, c’est ok.
10 Pour les enfants/adolescents, pourquoi c’est si difficile à la maison ?
- Quand un parent dit « tu dois écouter l’autre », l’enfant entend parfois « ta souffrance ne compte pas ».
- Il faut d’abord valider la blessure (« je comprends ce que tu ressens, c’est normal d’être en colère/triste… »), puis inviter à la perspective (« et à ton avis, qu’est-ce que l’autre ressentait ? »).
11 L’apport du modèle Vénoa (EPS/EPV) : aller plus loin que le simple conseil
- Ce verrouillage n’est pas juste une question de volonté ou d’intelligence, c’est une adaptation inconsciente face à la douleur, un mode de survie du cerveau (mécanisme de survie archaïque) pour ne pas revivre la douleur ancienne.
- Tant qu’une blessure n’est pas reconnue, la « perspective » reste un vœu pieux.
- Le chemin passe par l’accueil de sa propre histoire, et la certitude qu’on pourra, un jour, voir aussi celle de l’autre.
12 Pourquoi Bustamante passe-t-il sous silence la confrontation aux faits ?
En tant qu’ex-agent de la CIA, Bustamante a nécessairement une expertise pointue dans l’évaluation des faits et des informations ; pourtant, étrangement, il passe sous silence cette dimension cruciale.
Cela ouvre une réflexion plus vaste sur le discours public des experts (surtout ex-agents, psychologues, « gourous » du management, etc.) et les stratégies de communication destinées au grand public.
1. Hypothèses à explorer :
a) Stratégie pédagogique simplificatrice
- Pour toucher le grand public, il adopte un discours « positif » : il valorise l’écoute, l’ouverture, la curiosité, car ce sont des messages plus « faciles » à entendre, sans entrer dans la conflictualité.
- Parler de la confrontation aux faits, et donc de la manipulation, du refus de vérité, des risques d’abus, amènerait de la tension, risquerait de heurter ou de faire perdre son audience. Beaucoup de « coachings » modernes préfèrent les solutions séduisantes et déculpabilisantes.
b) Positionnement commercial
- Bustamante est devenu « consultant », « influenceur », il doit vendre des conférences, des formations. Un discours qui met l’accent sur la responsabilité individuelle et l’ouverture (« soyez curieux, soyez meilleurs ! ») fait vendre, car il donne l’illusion de la maîtrise sans effrayer.
- Souligner qu’il existe des cas où la perspective ne sert à rien face à la manipulation, ou qu’il faut parfois se protéger, poser des limites, voire rompre le lien, c’est beaucoup moins vendeur.
c) Évitement délibéré du conflit
- Un ex-agent de la CIA maîtrise parfaitement la complexité des interactions humaines, y compris la manipulation, le déni, la falsification des faits : il ne peut pas l’ignorer. Le passage sous silence est donc probablement délibéré, pour ne pas s’aliéner une partie de son public ou risquer la controverse.
- Il sait pertinemment que dans le réel, certaines personnes ne joueront jamais le jeu de la vérité (et il a dû en rencontrer pléthore), mais il choisit de ne pas l’aborder pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore.
d) Manœuvre de contrôle du récit
- Il peut y avoir un fond de manipulation : en simplifiant, il donne à son auditoire le sentiment que tout dépend d’eux, que la solution est accessible (« soyez en perspective et tout ira mieux »). Ce type de discours conforte l’ego, mais peut aussi isoler la victime (« si je n’y arrive pas, c’est ma faute »), au lieu de l’aider à repérer les vrais dangers.
- Ce schéma est très utilisé dans les milieux du développement personnel ou du leadership (« c’est à toi de changer, peu importe le contexte »), et permet d’éviter toute contestation de la structure, du système ou du rapport de force.
2. Conséquences : Un discours séduisant mais dangereux pour les plus vulnérables
- Pour un public averti, on peut voir le « trou » dans la théorie.
- Mais pour une personne réellement confrontée à la manipulation, au déni, ou au verrouillage psychique, ce discours peut conduire à la confusion, la culpabilité, voire l’auto-sabotage (« je dois être plus ouvert, c’est moi le problème… »).
- Cela peut même renforcer l’emprise du manipulateur, qui trouvera là une justification pour ne jamais reconnaître les faits.
3. Comment interpréter ce choix ?
- Ce n’est pas une omission innocente : Bustamante, ex-CIA, sait parfaitement que la réalité des faits est la clef de toute enquête, tout dialogue authentique.
- Il a donc sciemment choisi de ne pas aborder cette dimension, soit par souci d’accessibilité, soit par stratégie commerciale, soit par volonté d’éviter la complexité et le risque du conflit.
C’est là que la grille Vénoa propose un apport fondamental :
Elle nomme le problème, éclaire le verrouillage, ose parler du conflit avec la réalité, et donne aux personnes la légitimité de poser des limites quand l’autre refuse la confrontation aux faits.
13 Distinguer perception, perspective et faits
- Perception : Ma façon de voir le monde, mes filtres, mes blessures, mon histoire. Ce que je ressens est vrai pour moi. (Mais ce n’est pas forcément la réalité). La Perception c’est la réalité intérieure (ou ma réalité intérieure), ma façon singulière de ressentir et d’interpréter le monde. Elle est unique, forgée par mon histoire, mes émotions, mes blessures. La perception est indispensable pour comprendre ce que je vis, mais elle n’est jamais la réalité toute entière.
- Perspective : L’élargissement de mon regard : je prends en compte la vision de l’autre, j’ouvre mon écoute, je suspends mon jugement. Je ne cherche plus à avoir raison, mais à comprendre ce que l’autre vit. C’est l’effort de sortir de ma bulle, d’écouter la perception de l’autre, et d’ouvrir un espace où nos visions peuvent dialoguer. La perspective, ce n’est pas « fusionner » les points de vue, mais chercher ensemble ce qui fait sens, où nos réalités intérieures se rencontrent ou s’opposent. Elle est un pont, mais reste toujours relative aux perceptions de chacun. Je prends en considération les deux perceptions ce qui donne de la perspective.
- Faits : Ils relèvent de la réalité extérieure : ce qui s’est effectivement passé, ce qui peut être observé, constaté, vérifié indépendamment de nos ressentis. Les faits constituent le socle commun, la référence ultime pour sortir des malentendus et des manipulations. La justice, la réparation, la confiance ne peuvent reposer que sur l’établissement des faits, pas uniquement sur le dialogue des perceptions.
En résumé :
-La perception, c’est ma réalité intérieure.
-La perspective, c’est la rencontre de deux (ou plusieurs) réalités intérieures ou deux perceptions.
-Les faits, c’est l’ajout de la réalité extérieure, celle qui ne dépend pas de nous et qui sert de repère à la réalité partagée.
Exemple :
Perception (victime) : « J’ai été battue, personne ne me croit, je suis seule contre tous. »
Perception (accusé) : « Je n’ai rien fait, je suis accusé à tort, c’est moi qui ai été agressé, je suis la vraie victime. »
Perspective : Les deux côtés exposent leurs ressentis et leur version.
Faits : La justice cherche à établir ce qui s’est réellement passé : preuves matérielles, chronologies, expertises, c’est la base du jugement, au-delà de la seule parole de chacun.
La question qui se pose est : qu’est-ce que la réalité factuelle ?
Dans un monde idéal, elle serait l’ensemble des faits vérifiables, établis par une démarche objective, et non par l’opinion ou l’intérêt. Mais l’histoire montre que même les institutions chargées de l’établir, politiques, historiens, juristes, justice, peuvent la travestir, la minimiser ou la falsifier, consciemment ou non.
Dans ces cas, le danger est double :
- Les faits, censés être le socle commun, deviennent eux-mêmes un terrain de manipulation.
- Le consensus social ou institutionnel se confond avec la vérité, alors qu’il peut en être éloigné.
C’est pourquoi la vigilance face aux faits eux-mêmes est aussi importante que la vigilance face aux perceptions. La réalité factuelle authentique demande un examen critique constant, des sources variées, et la possibilité d’entendre les voix qui dérangent.
Bustamante met l’accent sur l’ouverture de son regard, Thucydide (voir article wetwo.fr/thucydide) – et la grille EPS/EPV – rappellent que sans ancrage dans les faits, l’ouverture devient une faille exploitable, menant à la domination de l’EPV et à l’effacement de la justice.
Sans réalité factuelle, non déformée ni manipulée, la perspective devient une illusion et la justice un mirage.
Car sans socle commun incontestable, chacun peut réécrire l’histoire à sa convenance, et l’on glisse alors vers un monde où la force impose sa vérité, effaçant la voix des plus vulnérables.
Chacun possède sa réalité intérieure, mais factuellement, il n’existe qu’une seule réalité : la réalité extérieure, celle qui s’est réellement produite, infalsifiable car existante en dehors de nous-mêmes.
Tout le défi est de la reconnaître sans la déformer, car c’est elle qui constitue le seul repère commun sur lequel justice et vérité peuvent se fonder.
14 La perception : un héritage ancien
La distinction entre perception et réalité n’est pas nouvelle. Depuis l’Antiquité, philosophes, psychologues et scientifiques s’y sont heurtés.
- Philosophie & phénoménologie
- Platon : l’allégorie de la caverne → nous confondons les ombres avec la réalité.
- Descartes : doute méthodique, distinction entre ce que je perçois et ce qui est réel.
- Kant : nous ne percevons jamais la chose en soi (noumène), mais seulement les phénomènes filtrés par notre esprit.
- Merleau-Ponty (Phénoménologie de la perception, 1945) : la perception est notre expérience primordiale du monde, incarnée et située.
- Psychologie & psychanalyse
- Freud : projection et transfert → nous voyons l’autre à travers notre inconscient.
- Jung : les archétypes et l’inconscient collectif structurent nos perceptions.
- Piaget : la perception et la cognition se construisent par étapes chez l’enfant.
- Winnicott : la perception du monde extérieur se construit dans l’oscillation entre illusion et réalité.
- Neurosciences & psychologie cognitive
- Helmholtz : la perception comme inférence inconsciente, le cerveau devinant la réalité à partir d’indices partiels.
- Neisser : perception = processus actif de sélection et d’organisation.
- Kahneman : nos jugements sont guidés par des heuristiques rapides, souvent biaisées.
- Antonio Damasio (L’erreur de Descartes) : émotions et perception sont inséparables – nous ne percevons jamais « objectivement », mais à travers le filtre de notre corps et de nos émotions. C’est lui qui ouvre le plus clairement la voie à une compréhension moderne des verrous émotionnels.
- Sociologie & constructivisme
- Goffman : nous ne percevons jamais la réalité brute, mais à travers des cadres sociaux.
- Berger & Luckmann : la réalité est construite, validée et institutionnalisée collectivement.
- Kant : la perception n’est jamais la réalité
Kant distingue entre le noumène (la chose en soi, inaccessible) et le phénomène (ce que nous percevons à travers nos filtres mentaux).
Ce qu’il annonce, c’est déjà que nous vivons dans une réalité interprétée, et non dans la réalité brute.
Dans la grille EPS/EPV : cela montre que la perception de chacun est limitée, mais l’EPV transforme cette limite en certitude absolue (il croit voir « la chose en soi »), tandis que l’EPS garde une ouverture à la remise en question.
- Freud et Jung : l’inconscient dans la perception
Freud met en lumière la projection : nous attribuons à l’autre ce que nous refoulons en nous.
Jung ajoute l’idée d’archétypes et d’inconscient collectif, qui façonnent ce que nous croyons voir.
Tous deux montrent que notre perception de l’autre est traversée par des couches inconscientes.
Dans la grille EPS/EPV : l’EPV projette massivement pour se protéger, l’EPS peut aussi projeter mais garde une capacité à reconnaître ses propres ombres si un espace de confiance existe.
- Damasio : quand l’émotion guide la perception
Il apporte la preuve neuroscientifique que perception et émotion sont indissociables, et que bloquer l’émotion (comme le fait dans l’inconscient l’EPV) entraîne une distorsion de la perception.
En résumé :
- Kant → la perception est limitée.
- Freud/Jung → elle est influencée par l’inconscient.
- Damasio → elle est indissociable de l’émotion et du corps.
- La grille EPS/EPV → elle explique pourquoi certaines perceptions se verrouillent et deviennent irréconciliables, et comment d’autres peuvent évoluer vers plus de lucidité.
Ce rapide panorama montre que la perception a toujours été au cœur des interrogations humaines, mais rarement expliquée dans ses blocages psychiques et relationnels.
La grille EPS/EPV s’inscrit dans cette lignée, cependant elle explique pourquoi certaines perceptions deviennent impossibles à remettre en question (verrouillage EPV) et comment d’autres (EPS) peuvent, avec du soutien, évoluer vers plus de lucidité.
Parmi ces auteurs, l’un occupe une place particulière : Antonio Damasio. En reliant émotions, corps et perception, il a ouvert une voie qui rejoint directement ce que la grille EPS/EPV met en lumière.
14.1 Antonio Damasio : quand l’émotion guide la perception
Avec L’erreur de Descartes (1994), Antonio Damasio a ouvert une brèche décisive dans notre compréhension de la perception. Là où l’on pensait que les émotions brouillaient la raison, il a montré au contraire qu’elles en sont la condition.
Ses recherches auprès de patients cérébraux ont révélé que :
- Sans émotion, il n’y a plus de décision possible. Des individus privés de certaines aires émotionnelles pouvaient décrire une situation avec précision, mais restaient incapables d’agir, comme paralysés par l’absence de ressenti.
- Toute perception est imprégnée d’affect. Ce que nous voyons, entendons ou interprétons n’est jamais neutre : c’est toujours traversé par la tonalité émotionnelle qui nous habite.
- Le corps est au cœur de la perception. Ce ne sont pas seulement nos yeux ou nos oreilles qui perçoivent, mais l’ensemble de nos états corporels, qui colorent la réalité d’une intensité émotionnelle.
Cette découverte bouleverse le schéma cartésien qui séparait raison et émotions. Damasio démontre que la perception « pure » n’existe pas : elle est toujours déjà orientée, amplifiée ou déformée par l’émotion.
C’est exactement ce que la grille EPS/EPV éclaire :
- L’EPV verrouille sa perception en bloquant l’accès à certaines émotions insupportables. Ce qui est perçu est alors amputé, réécrit pour protéger l’ego.
- L’EPS, au contraire, garde un accès à ses émotions, parfois douloureux ou submergeant, mais qui lui permet une forme de lucidité plus directe, tant qu’il ne s’y perd pas.
Damasio offre une validation neuroscientifique à ce que nous expérimentons dans nos vies relationnelles : la perception n’est jamais qu’une affaire d’yeux ou d’oreilles, mais toujours une affaire de blessures, de mémoire émotionnelle et de corps.
15 Conclusion, s’ouvrir à la perspective, c’est un chemin de guérison mutuelle
Changer de perception, ce n’est pas trahir sa souffrance, c’est lui donner un sens, et s’offrir (enfin) la possibilité d’une rencontre vraie. La perspective, c’est accepter que chacun porte ses fantômes, et que personne n’a « toute la vérité ». C’est le début d’un dialogue plus humble, plus humain, où chacun apprend à devenir adulte émotionnellement.
Identifier si l’on est face à une perception honnête ou à une distorsion de la réalité est la première étape vers une relation adulte et respectueuse en s’affranchissant du déni.
La vérité n’est pas un consensus, elle est ce qui résiste aux manipulations.

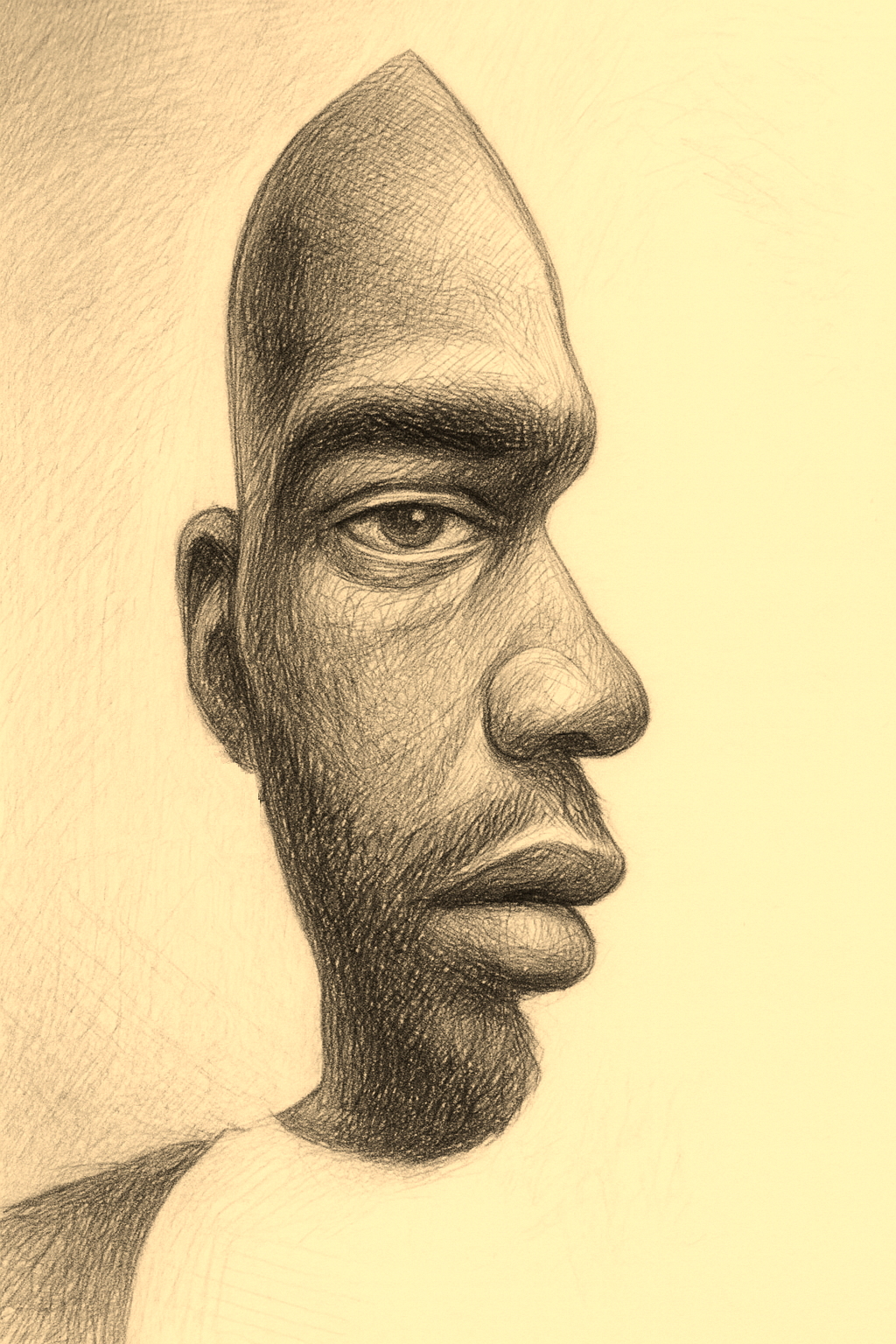
Laisser un commentaire