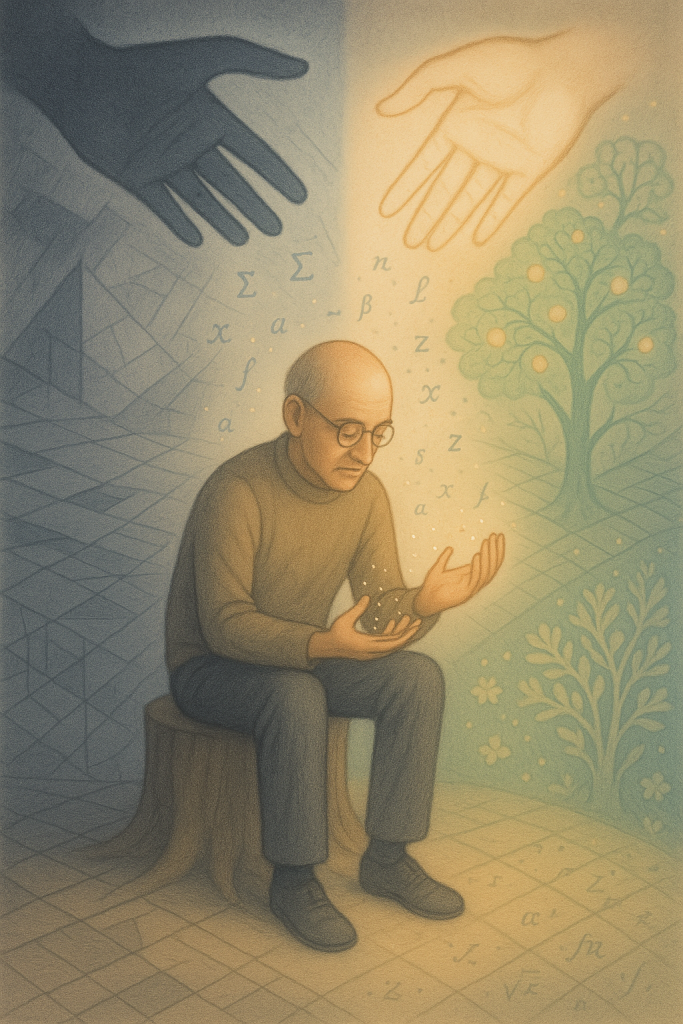
Portrait d’un Enfant Perdu Sensible en rupture avec un monde verrouillé
Table des matières
2 Une enfance marquée par la blessure. 2
3 Une sensibilité extrême canalisée dans l’abstraction. 3
4 Le basculement : du génie au retrait 3
5 Le cri discret de l’EPS : besoin de profondeur 4
6 Une obsession pour le mal déguisé en bien. 4
7 Lien entre la vision de Grothendieck et le modèle EPS/EPV : 6
8 Pourquoi le monde verrouillé ne peut accueillir l’EPS radical 7
9 Grothendieck, miroir d’une question plus large. 8
10 Hommage à une conscience libre. 8
11 Ce que Grothendieck n’a pas pu nommer 8
12 Redonner un visage aux invisibles. 9
13 Une invitation à ceux qui cherchent la profondeur 10
V03-05/25
1 Introduction
On retient souvent de lui l’image d’un génie mathématique absolu, l’un des plus brillants du XXème siècle, mais aussi d’un homme radicalement retiré du monde. Alexandre Grothendieck a fasciné par ses théories, puis troublé par son silence. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il fut aussi, peut-être avant tout, un homme blessé par le manque de profondeur humaine, par l’absence de lien véritable. Un Enfant Perdu Sensible (EPS) (voir article invisible) dans toute sa vérité.
Lors d’une conférence au CERN en 1972, il prononce cette phrase, simple mais bouleversante :
« Je ne pousserai plus de relation amoureuse avec une femme que dans la mesure où elle me semblerait être un moyen pour établir une communication plus profonde. »
Ce n’est pas une simple réflexion sur les relations. C’est un cri. Une déclaration de survie émotionnelle. Grothendieck ne cherchait pas simplement des relations, il cherchait un lien authentique, une résonance qui dépasse les apparences et les faux-semblants.
Cette phrase, d’apparence banale, révèle en réalité une fissure essentielle : celle de l’âme qui, trop souvent, a cherché le lien dans des lieux où il n’était pas.
Ce texte propose de relire son parcours à la lumière du modèle EPS/EPV, non pour le réduire, mais pour rendre visible ce que la biographie classique ne dit pas : la souffrance d’être sensible dans un monde qui ne l’est pas.
2 Une enfance marquée par la blessure
Fils de militants anarchistes, Grothendieck connaît très tôt l’insécurité, le déracinement, le manque d’ancrage affectif. Son père, Alexandre Schapiro, réfugié russe, est arrêté et déporté à Auschwitz, où il meurt. Sa mère, Hanka Grothendieck, l’élève dans des conditions précaires, marquées par l’errance et la lutte.
Ce que l’enfant perçoit avant tout, c’est l’absence de sécurité émotionnelle. Confié très jeune à une famille d’accueil, il apprend que les liens peuvent se rompre, que la confiance n’est jamais acquise.
Cette enfance sans stabilité, sans vraie sécurité affective, pose les bases d’une blessure profonde : celle de ne pas être sûr d’exister pour quelqu’un. L’enfant qu’il était n’a pas pu être véritablement reconnu dans sa vulnérabilité. Il a appris à survivre, pas à se sentir aimé.
On pourrait dire que c’est là que naît l’Enfant Perdu Sensible en lui : un être lucide, hyper-conscient du monde, mais dépourvu de miroir humain où se voir avec tendresse.
3 Une sensibilité extrême canalisée dans l’abstraction
Grothendieck se tourne vers les mathématiques avec une intensité qui frise la transcendance. Il y cherche un ordre, une cohérence, un langage pur que le monde humain ne lui offre pas. Mais cette quête est aussi une forme de refuge.
Les mathématiques deviennent une île où il peut fuir la confusion émotionnelle, les attentes non dites, la violence relationnelle. Il structure l’infini là où les relations humaines semblent fragmentées.
Cette logique parfaite ne suffit pas à combler la faim de vécu. Sa sensibilité reste intacte, en creux.
C’est un EPS qui canalise la surcharge de sa sensibilité dans la structure mentale. Il ne fuit pas : il transforme, il sublime sa douleur en structures universelles.
4 Le basculement : du génie au retrait
Au sommet de sa carrière, il décide de tout quitter. L’IHÉS, les honneurs, les publications, les disciples. Il part. Ce choix radical, que beaucoup ne comprennent pas, est le signe clair d’un EPS arrivé au point de rupture.
La conscience trop éveillée.
« Je ne peux plus continuer à faire comme si tout cela n’existait pas. »
Il refuse de voir ses intuitions transformées en outils sans âme. Il rejette le cynisme des institutions scientifiques. Il dénonce même l’usage militaire de la science. Il ne peut plus coopérer avec un monde qui a perdu le sens. Son retrait est une fidélité à son intégrité.
Mais ce choix l’isole. Comme beaucoup d’EPS, il devient invisible aux yeux du collectif. Trop sensible, trop profond, trop intègre pour un monde dominé par les automatismes EPV.
Grothendieck a fui les honneurs, les institutions, les rapports de pouvoir.
Non par marginalité gratuite, mais parce qu’il ne pouvait plus faire semblant.
Sa conscience aiguë du mal déguisé en bien – cette manipulation douce du langage, du savoir, du pouvoir – l’a poussé à se retirer du monde.
Il a reconnu la souffrance là où d’autres ne voyaient qu’ambition ou efficacité.
Ce qu’il écrit à la fin de sa vie, dans ses 50 000 pages de manuscrits, entre quête spirituelle, recherche sur le mal qui se cache derrière de faux semblants et la déshumanisation, rejoint exactement la lecture du modèle EPS/EPV :
un monde verrouillé émotionnellement, où ceux qui ressentent trop sont vus comme fous ou marginaux.
Mais ce sont eux qui perçoivent la dissonance.
Grothendieck a, perçu – avec une lucidité rare – les rouages du mal sous sa forme la plus insidieuse : celle qui se cache sous le masque du bien, de la raison, de la normalité. Il a vu que le monde humain était traversé par une logique inversée, où la souffrance est refoulée, où le pouvoir se camoufle en bienveillance, où l’automatisme émotionnel devient structure sociale.
5 Le cri discret de l’EPS : besoin de profondeur
Cette quête de profondeur n’est pas un caprice, c’est un besoin vital. Pour Grothendieck, le lien ne peut être superficiel. Toute relation qui n’atteint pas cette profondeur devient une déception.
« …Et également, et peut-être surtout, l’établissement, disons, de la communication entre les personnes, qui est devenu extrêmement pauvre, je pense, dans notre civilisation.
J’ai fait assez récemment, j’ai fait un peu le bilan de ma propre vie, et des relations humaines que j’ai eues, et j’ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre. »
Pour ses partenaires, ses amis, ses enfants, cette quête pouvait sembler étouffante. Car elle mettait en lumière ce que beaucoup préfèrent éviter : la superficialité des liens, l’absence de communication réelle.
Dans la relation amoureuse, il avait besoin d’une communication plus profonde.
Cette phrase, prononcée tard dans sa vie, est bouleversante. Elle condense une solitude longue, une déception répétée, et un besoin d’être enfin rejoint. Non pas par admiration, mais par présence. Non pas dans la performance intellectuelle, mais dans le ressenti partagé.
C’est un aveu d’EPS : ce n’est pas de reconnaissance dont j’ai besoin. C’est de lien. D’un lien égal, sensible, profond.
Ce cri discret fait écho à celui de tant d’autres EPS, qui n’ont jamais vraiment pu dire ce qu’ils ressentaient. Et qui, un jour, se taisent.
6 Une obsession pour le mal déguisé en bien
Grothendieck n’était pas seulement un homme de profondeur. Il était aussi un homme obsédé par une forme spécifique de mal :
« Lui, il était obsédé par le mal déguisé en bien, par les gens qui font le mal en toute bonne conscience, qui ont une image d’eux-mêmes comme étant des gens absolument parfaits. »
Cette lucidité, cette sensibilité extrême, l’ont isolé. Car il voyait là où les autres préféraient détourner le regard.
Grothendieck décrivait ce qu’il appelait le « mal déguisé en bien », cette capacité des individus à justifier leurs actions destructrices par une image de perfection ou de vertu.
- C’est exactement ce que le modèle EPS/EPV met en lumière : l’EPV, verrouillé émotionnellement, se justifie toujours par une rationalisation.
- Le contrôle, la domination ou la soumission deviennent des valeurs morales : obéir, diriger, imposer… mais toujours « pour le bien des autres ».
- Les systèmes sociaux, les institutions et même les relations personnelles deviennent des espaces de manipulation, où chacun justifie ses actes en se pensant « juste » ou « bienveillant ».
- Le mal ne se présente jamais comme une force brute : il se dissimule sous le masque de la raison, du devoir, de l’ordre.
Mais il ne voyait pas seulement ce mal au niveau individuel. Il percevait sa diffusion à toutes les échelles de la société :
« Parmi les transformations à effectuer précisément, il y a je crois, le dépassement de l’attitude de compétitivité entre personnes, le dépassement de l’attitude du désir de domination des uns par rapport aux autres, qui engendre d’autre part le désir de soumission à l’autorité. Je crois qu’on a là deux aspects de la même tendance. »
Ce mal déguisé en bien n’est pas seulement individuel. C’est une dynamique sociale. Les systèmes politiques, les institutions, les idéologies justifient la domination et la manipulation au nom de principes vertueux.
Ce qu’il décrit ici, c’est exactement ce que le modèle EPS/EPV met en lumière :
- Au niveau individuel (Micro) : la domination dans les relations personnelles, le contrôle, l’évitement émotionnel.
- Au niveau relationnel (Meso) : les couples et les familles où l’un domine et l’autre se soumet, ou où les enfants reproduisent les schémas des parents.
- Au niveau sociétal (Macro) : les institutions, les systèmes politiques, les entreprises qui reposent sur la compétition, la hiérarchie, et la soumission.
Grothendieck avait perçu cette dynamique avec une lucidité rare. Mais ce qu’il n’a peut-être pas pu nommer, c’est le mécanisme intime qui la sous-tend : la blessure émotionnelle qui, non reconnue, se transforme en automatisme, en contrôle, en domination.
7 Lien entre la vision de Grothendieck et le modèle EPS/EPV :
Grothendieck avait perçu avec une lucidité rare que la société, dans son ensemble, était traversée par une dynamique de contrôle et de soumission. Ce qu’il décrivait comme « l’attitude de compétitivité, le désir de domination et la soumission à l’autorité » correspond précisément aux mécanismes de l’EPV (Enfant Perdu Verrouillé) dans le modèle EPS/EPV.
- L’EPV (Enfant Perdu Verrouillé) est une personne qui, pour survivre à une blessure émotionnelle non reconnue, a verrouillé l’accès à ses émotions. Pour se protéger, il développe un besoin de contrôle, de domination ou d’adhésion rigide à une autorité extérieure.
- Ce mécanisme, qui commence au niveau individuel (Micro), se reproduit au niveau relationnel (Meso) et finit par structurer la société elle-même (Macro).
- Grothendieck percevait que cette dynamique n’était pas seulement personnelle, mais qu’elle se diffusait à toutes les échelles :
- Individuel : les relations où l’un contrôle et l’autre se soumet.
- Relationnel : les couples, les familles, les groupes sociaux où les rôles de domination et de soumission se reproduisent.
- Sociétal : les institutions, les systèmes politiques, les entreprises qui reposent sur la hiérarchie, la compétition, et la soumission à l’autorité.
Une vision qui rejoint le modèle EPS/EPV :
- Grothendieck avait identifié que cette dynamique était une tendance fondamentale de la nature humaine, mais il n’avait peut-être pas pu en comprendre la source intime : la blessure émotionnelle qui verrouille la conscience (peut être que cela fait partie des livrets qu’il a écrits et qui restent à être lus).
- Là où il voyait un phénomène social, le modèle EPS/EPV montre qu’il s’agit d’un mécanisme psychologique profond, qui se déclenche lorsqu’un être humain, pour se protéger d’une souffrance, se ferme à ses propres émotions.
- Ce verrouillage se traduit ensuite par le contrôle, la domination, ou la soumission – les trois facettes d’une même dynamique défensive.
Ce que Grothendieck percevait de manière instinctive, la lecture du modèle EPS/EPV le formalise clairement.
- Il voyait la surface : la domination, la soumission, la compétition.
- la racine est ici : la blessure émotionnelle non reconnue, qui verrouille la conscience et transforme les êtres en automates émotionnels (EPV).
- Ce que lui appelait « le mal déguisé en bien », est définie dans le modèle comme une rationalisation défensive des EPV, qui justifient leurs comportements destructeurs tout en se pensant justes.
Grothendieck a tenté de percer ce voile de rationalisation pour toucher à une vérité humaine plus profonde. C’est cette même quête qui anime ce modèle EPS/EPV : une volonté de mettre à nu les mécanismes inconscients qui nous enferment, individuellement et collectivement.
Là où Grothendieck voyait une dynamique de contrôle et de soumission, le modèle EPS/EPV révèle la racine invisible : la blessure émotionnelle non reconnue, qui verrouille la conscience et pousse à dominer ou à se soumettre.
8 Pourquoi le monde verrouillé ne peut accueillir l’EPS radical
Dans un monde dominé par la productivité, la compétition et l’image sociale, l’EPS profond fait peur. Il dérange. Il agit comme un miroir silencieux face à ceux qui ont coupé l’accès à leurs émotions.
Grothendieck, par sa radicalité éthique et existentielle, ne pouvait qu’être rejeté. Il refusait de jouer le jeu. Il montrait que l’on pouvait penser sans se vendre, vivre sans se soumettre. Et c’est précisément cela que le système verrouillé ne peut tolérer.
Alors il est devenu invisible. Effacé, puis marginalisé. Et pourtant, il a persisté dans sa fidélité à lui-même, comme beaucoup d’EPS qui choisissent le silence plutôt que la trahison de leur intégrité.
Grothendieck a tenté de redonner un visage aux invisibles, aux disparus, aux oubliés des camps.
Il a vu que derrière l’ordre, la structure, l’État, se cache souvent une violence sans nom.
Ce n’était pas un rejet du savoir.
C’était une tentative désespérée de le remettre au service du vivant.
Il lui manquait un outil.
Il n’avait pas encore cette lecture du verrouillage de la conscience par la blessure.
Ce modèle qui explique pourquoi le monde lui semblait devenu fou.
S’il avait eu la grille EPS/EPV, il aurait pu décrypter les mécanismes qu’il observait partout dans la société.
9 Grothendieck, miroir d’une question plus large
Combien d’êtres sensibles, profonds, ont été mis de côté, jugés inadaptés, trop intenses ou trop instables ? Combien ont choisi le retrait plutôt que la compromission ? Combien sont morts, même symboliquement, d’être n’avoir jamais été reconnus dans leur manière d’être au monde ?
Grothendieck n’est pas une exception. Il est un symbole. Celui de tous les EPS qui n’ont pas trouvé leur place dans un monde trop étroit pour leur ampleur. Et il pose une question dérangeante : que vaut une société qui marginalise ses consciences les plus fines ?
10 Hommage à une conscience libre
Reconnaitre Grothendieck comme un EPS, ce n’est pas le figer dans une lecture psychologique. C’est lui redonner une place dans notre humanité commune. C’est honorer non seulement son génie, mais sa sensibilité.
Il n’était pas seulement un homme de logique. Il était un homme de vérité, dans ce qu’elle a de plus exigeant et de plus nu.
Et peut-être que son silence final n’était pas un renoncement, mais un choix : celui de ne plus participer à une comédie déshumanisante. Celui de vivre, enfin, selon le rythme de son âme.
Il n’a pas disparu. Il a juste cessé de trahir son cœur.
11 Ce que Grothendieck n’a pas pu nommer
Grothendieck avait entrevu l’inversion du bien et du mal, la manipulation cachée dans les structures sociales, l’usage dévoyé de l’intelligence au service du pouvoir. Il avait compris la déshumanisation à l’œuvre dans les institutions, le savoir, la science, les relations humaines.
Mais ce qu’il n’a peut-être pas pu nommer, c’est le mécanisme intime du verrou : le fait que le conscient lui-même puisse être manipulé par l’inconscient blessé, que le mal ne soit pas une volonté extérieure, mais souvent un automatisme intérieur non reconnu.
Il a porté seul une vision immense. Mais sans cadre pour l’éclairer, sans soutien humain pour la contenir, il s’est replié.
Aujourd’hui, grâce aux outils ici décrits, à l’écoute fine de la blessure, à la compréhension des dynamiques EPS/EPV, on peut poser ce qu’il ressentait sans l’avoir reçu : un langage pour guérir.
Ce qu’il a vu était juste.
Ce qu’il a vécu était immense.
Ce qu’il n’a pas pu dire, on peut aujourd’hui le déplier.
Et c’est peut-être là, enfin, que commence notre responsabilité.
12 Redonner un visage aux invisibles
Grothendieck n’a pas seulement quitté les mathématiques.
Dans ses dernières années, Grothendieck s’est lancé dans une quête poignante : retrouver et réciter les noms des déportés, notamment à Auschwitz.
Il ne cherchait pas seulement à sauver des noms : il a voulu restaurer la dignité humaine là où elle avait été niée.
En récitant les noms des disparus, c’est peut-être sa propre présence au monde qu’il cherchait à réaffirmer, dans un monde où il se sentait lui-même oublié.
Ce geste n’était pas seulement un hommage. C’était une réparation. Il voulait rendre un visage à ceux que l’Histoire avait effacés. Il savait, au plus intime, ce que signifie être déshumanisé, invisibilisé.
C’était aussi, peut-être, une manière pour lui de donner un visage à sa propre souffrance, de dire qu’il voyait ceux que l’on oublie, parce qu’il se sentait lui-même oublié.
Il n’a pas seulement cherché à sauver des noms : il a voulu restaurer la dignité humaine là où elle avait été niée. Parce qu’il savait ce que cela faisait, d’être non vu. D’être réduit à une fonction, à un statut, à un chiffre -ou à un silence, empêcher l’oubli.
Ce n’était pas un geste intellectuel. C’était un acte d’amour. Une façon de dire à ces âmes : je vous vois. Une façon, peut-être, de faire pour les autres ce que personne n’avait fait pour lui.
Ce geste, presque mystique, de mémoriser des noms perdus, c’est exactement ce que fait un Enfant Perdu Sensible libéré : il tente de réparer le lien entre l’humanité et l’invisible, entre la souffrance et la mémoire, entre la conscience et la vérité.
Grothendieck ne fuyait pas l’humain : il pleurait de ne pas pouvoir le rejoindre vraiment
Libéré, il aurait pu apporter tant à la société.
Et pourtant, même enfermé, il a laissé un sillage. Une trace de conscience, de lucidité et d’intégrité.
Ce qu’il n’a pas pu vivre pleinement, nous pouvons aujourd’hui le prolonger. En lui rendant sa voix. En l’écoutant, vraiment.
13 Une invitation à ceux qui cherchent la profondeur
Grothendieck n’est pas qu’un nom dans l’histoire des mathématiques. Il est une question posée à chacun de nous. Une question vive, brûlante : Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour la vérité ? Pour la profondeur ?
Dans un monde où la superficialité domine, où les apparences masquent l’essentiel, chercher la profondeur est un acte de courage. Refuser de se perdre dans les mensonges doux, dans les conversations vides, dans les relations sans âme, c’est une forme de résistance.
Dans un monde où les relations sont réduites à des échanges de façade, la quête de profondeur de Grothendieck nous rappelle que la véritable humanité commence par une rencontre sincère.
Si cette quête vous parle, alors vous n’êtes pas seuls. Et peut-être que la voix de Grothendieck, avec sa lucidité tranchante et son besoin déchirant de vérité, est là pour vous rappeler que vous n’êtes pas fous, que vous n’êtes pas trop exigeants. Vous êtes simplement vivants.
Et peut-être qu’aujourd’hui, comprendre cette quête, c’est aussi apprendre à ne plus être seul avec elle.
Mais cette quête de profondeur a un prix. Elle isole. Elle dérange. Elle expose les faux-semblants, les rationalisations, les mensonges déguisés en bienveillance. Elle révèle ce que beaucoup préfèrent ignorer : que derrière les sourires, derrière les discours vertueux, il y a souvent une peur cachée, un verrou émotionnel non reconnu.
C’est ce que Grothendieck avait perçu : la dissociation entre l’apparence et l’essence, entre les mots et la vérité, entre le lien simulé et la connexion véritable.
Pourtant, cette quête de profondeur n’est pas une faiblesse. C’est une force. Une force fragile, mais immense. Celle de ceux qui ne se contentent pas de survivre. Celle de ceux qui choisissent de vivre.
Et peut-être que cette quête de profondeur, qui fut pour Grothendieck une souffrance, peut devenir pour nous une lumière. Un chemin.
Comprendre Grothendieck, ce n’est pas seulement reconnaître son génie. C’est se poser cette question essentielle : Suis-je prêt à vivre vraiment ? Suis-je prêt à voir ce qui est, plutôt que ce qui rassure ? Grothendieck nous laisse une voix, un sillage, un appel. Celui de ne jamais trahir son cœur, même quand le monde préfère les illusions.


Laisser un commentaire