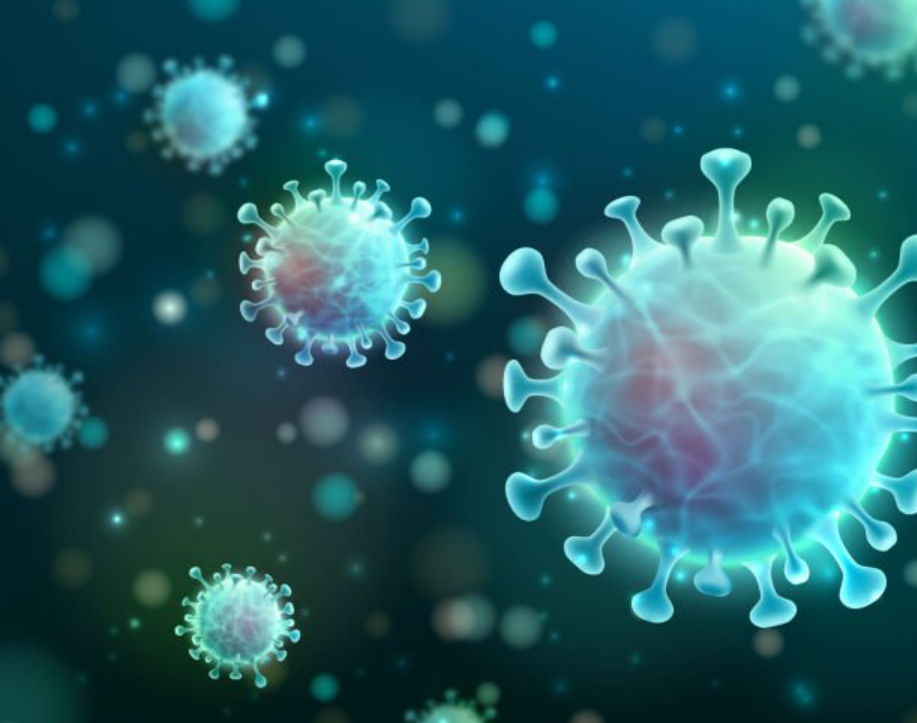
1.1 Héritage et sacrifice : décrypter les dynamiques inconscientes de la crise. 1
2.2 La génération de l’après-guerre : besoin de contrôle et déni de ses propres failles. 3
2.3 Le biais religieux du sacrifice : un inconscient collectif toujours puissant 4
2.4 L’inversion des valeurs : sacrifier ceux qui auraient dû être protégés. 4
2.5 Le déni d’un autre facteur : la peur de voir les dégâts collatéraux. 5
2.6.1 Biais d’autorité et de confirmation. 6
2.6.2 Biais de cadrage et effet de la rhétorique de peur 6
2.6.3 Rôle des réseaux sociaux et de la polarisation. 6
2.6.4 Biais d’omission et invisibilisation des souffrances. 6
2.7 Perspective historique et comparaisons inter-crises. 7
2.7.1 Pandémie de grippe espagnole (1918-1919) 7
2.7.2 Crises sanitaires récentes (SARS 2003, H1N1 2009, MERS 2012) 7
2.7.3 L’évolution de la communication et le rôle des réseaux sociaux. 7
2.7.4 Comparaison avec d’autres crises socio-économiques. 7
2.7.5 Quand le clivage alimente le contrôle renforcé : une analyse de la crise. 8
2.8 Vers un rééquilibrage : reconnaître les angles morts. 8
1 Pré introduction
1.1 Héritage et sacrifice : décrypter les dynamiques inconscientes de la crise
Pré-introduction
La pandémie de Covid-19 a révélé bien plus qu’une simple crise sanitaire ou économique ; elle a mis en exergue des dynamiques psychologiques et culturelles profondément enracinées. Derrière les mesures de confinement, les injonctions à la vaccination et les discours moralisateurs se cachent des héritages historiques et religieux qui continuent de modeler nos sociétés. La gestion de cette crise apparaît ainsi à travers le prisme de la génération de l’après-guerre, dont le besoin de contrôle et le déni des blessures personnelles ont nourri une logique sacrificielle.
Paradoxalement, cette approche a mené à une inversion des valeurs, privilégiant la protection d’un groupe jugé « élu » au détriment de ceux qui auraient dû être les véritables protégés.
Ce préambule se propose de jeter un regard critique sur ces mécanismes inconscients, afin de mieux comprendre l’enchevêtrement complexe entre pouvoir, croyances et souffrances humaines dans le contexte pandémique.
2 Introduction
2.1 La pandémie de Covid-19, entre héritage de l’après-guerre, logique du sacrifice et inversion des valeurs
La crise de la Covid-19 a donné lieu à des mesures et des discours d’une ampleur inédite : confinements, injonctions à la vaccination, passe sanitaire, etc. Au-delà de la dimension sanitaire, il est intéressant de l’analyser sous plusieurs angles souvent négligés :
- L’héritage psychologique et politique de la génération de l’après-Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui aux commandes.
- L’imprégnation d’une logique religieuse de « sacrifice » dans notre culture occidentale.
- Une « inversion des valeurs » : le sacrifice a concerné ceux qui, en principe, auraient dû recevoir le plus de protection (les jeunes et les plus fragiles économiquement), tandis que les plus âgés actifs, dotés du pouvoir et des ressources, se sont retrouvés davantage « cocoonés ».
Il convient également de souligner que la logique sacrificielle n’a pas seulement impacté la jeunesse ou les actifs, mais a également laissé des traces profondes dans les établissements dédiés aux personnes âgées, tels que les hôpitaux et les EHPAD. Dans ces milieux, la dimension affective et psychologique a été largement négligée. L’isolement imposé par les mesures sanitaires – qui interdisait, pendant de longues périodes, aux familles de rendre visite à leurs proches – a engendré un sentiment d’abandon et de détresse émotionnelle difficile à mesurer. Ce manque de contact humain essentiel a parfois eu des conséquences tragiques, exacerbant la vulnérabilité des résidents et soulignant l’urgence de prendre en compte, dans les politiques publiques, non seulement les aspects médicaux et sanitaires, mais aussi les besoins affectifs et psychologiques. Cette réalité rappelle que le sacrifice imposé ne se limite pas à une injonction morale, mais se traduit concrètement par une douleur humaine que l’on ne peut ignorer.
- Un déni difficile à avouer : la volonté de ne pas regarder en face les dégâts collatéraux et la souffrance infligée à certaines tranches de la population.
2.2 La génération de l’après-guerre : besoin de contrôle et déni de ses propres failles
Les dirigeants politiques, hauts fonctionnaires et décideurs économiques appartiennent majoritairement à la génération née ou ayant grandi dans l’après-guerre (environ 60-80 ans). Leur éducation, marquée par la reconstruction d’après 1945, valorise la force, la stabilité et la sécurité. Deux caractéristiques ressortent :
- Un réflexe de sécurisation
Toute menace – même non comparable à une guerre – peut déclencher une réponse autoritaire ou restrictive. La crainte d’un nouveau « chaos » (ici sanitaire) a donc favorisé des mesures radicales (confinements, couvre-feux, etc.).
- Un déni des blessures psychologiques
Le véritable problème réside dans l’incapacité, voire la réticence, des décideurs à prendre en charge leurs propres blessures émotionnelles et inconscientes avant de chercher à « sauver » les autres. Plutôt que de s’ériger en sauveurs du peuple, ils gagneraient à entreprendre un processus introspectif afin de traiter en conscience leurs traumatismes intérieurs. Ce travail sur soi est indispensable pour surmonter la tentation de projeter leurs propres insécurités sur la population et éviter ainsi un discours paternaliste, déconnecté de la réalité vécue par les citoyens.
Cette situation trouve ses racines dans une culture d’après-guerre qui reposait sur le mantra « Sois fort, ne te plains pas ». Ce conditionnement a conduit à ce que de nombreux traumatismes – pertes familiales, angoisses, pauvreté – restent tus et non soignés. Par conséquent, cette génération tend à externaliser son insécurité, que ce soit en interprétant la menace du virus ou en imposant des injonctions telles que « Faites votre devoir » ou « Protégez les plus fragiles », sans remettre en question sa propre vulnérabilité. Il est pourtant essentiel qu’elle prenne conscience de ses blessures et les soigne, avant de prétendre réparer celles du peuple, afin d’instaurer une gouvernance véritablement responsable et en phase avec la réalité de chacun.
2.3 Le biais religieux du sacrifice : un inconscient collectif toujours puissant
Malgré la sécularisation de nos sociétés, l’héritage judéo-chrétien reste ancré dans l’inconscient collectif : le récit du sacrifice (celui du Christ, du bouc émissaire, etc.) continue de structurer nos imaginaires. Ainsi, lors de la pandémie:
Les plus âgés actifs ont été implicitement perçus comme les « élus à préserver » ou « dignes de la plus grande protection ».
Les « plus âgés actifs » – ceux qui, en dépit de leur âge, continuent d’exercer une influence économique, politique ou sociale – et qui bénéficient d’une image de « dignité à préserver » dans le discours officiel. Cela contraste avec la réalité des personnes âgées les plus vulnérables, notamment celles confinées en EHPAD ou en milieu hospitalier, qui, malgré leur fragilité, ont été isolées et ont subi des conséquences tragiques sur le plan affectif et psychologique.
Les jeunes et les actifs se sont retrouvés en position de « sacrifiés » : ils devaient consentir aux restrictions, à la vaccination obligatoire de fait, au confinement, même s’ils étaient statistiquement moins exposés aux formes graves.
Dans une logique religieuse traditionnelle, on honore ou on valorise celui qui se sacrifie. Or, ici, le discours s’est souvent contenté de culpabiliser les jeunes s’ils ne se conformaient pas aux directives, sans jamais reconnaître l’ampleur de leur souffrance ou de leurs besoins.
Le résultat ? De nombreux étudiants et jeunes travailleurs ont subi isolement, précarité et crises d’angoisse, parfois jusqu’au suicide.
2.4 L’inversion des valeurs : sacrifier ceux qui auraient dû être protégés
Cette situation a mis en évidence une inversion des valeurs particulièrement frappante :
Normalement, on attend qu’une société protège en priorité ses plus jeunes, qui représentent l’avenir, ou ceux qui sont déjà en difficulté économique, sociale ou psychologique.
Dans les faits, on a surtout protégé la frange plus âgée active – parfois la plus nantie ou la plus influente – en exigeant des sacrifices majeurs de la part de ceux qui étaient pourtant loin d’être à l’abri financièrement ou socialement.
Cette inversion est d’autant plus dérangeante qu’elle s’est faite sous couvert d’un discours « moral » : sauver des vies, préserver les fragiles, rester solidaire. La jeunesse s’est ainsi retrouvée « bouc émissaire » d’un récit où, paradoxalement, elle était vue comme potentiellement dangereuse (risque de contamination) alors même qu’elle était la plus vulnérable aux conséquences socio-économiques.
2.5 Le déni d’un autre facteur : la peur de voir les dégâts collatéraux
Au-delà de l’héritage générationnel et du biais religieux, un dernier facteur semble à l’œuvre : un déni, sans doute difficile à avouer, de la réalité des impacts sur ceux qui ont été sacrifiés. Ce déni peut prendre plusieurs formes :
- Minimiser ou ignorer les dommages
Peu de place médiatique a été accordée aux suicides, à la détresse psychologique des jeunes, aux faillites d’entrepreneurs ou aux conséquences à long terme sur l’éducation et la santé mentale.
- Refuser la culpabilité
Reconnaître les effets négatifs des mesures revient à admettre qu’on a consciemment ou inconsciemment infligé une forme d’injustice à une partie de la population. Il est parfois plus « simple » de rester dans le déni et de défendre ses choix en bloc (« il n’y avait pas d’alternative »).
- Conserver l’illusion du « bien commun »
Dans la logique du sacrifice, on croit sincèrement œuvrer pour le salut collectif. Admettre qu’on a sacrifié les moins puissants pour rassurer les plus puissants met à mal cet idéal moral.
2.6 Autres biais et dénis
2.6.1 Biais d’autorité et de confirmation
- Biais d’autorité : Le discours des autorités a souvent été suivi sans remise en question, ce qui a renforcé la crédulité collective. Ce biais explique pourquoi certains segments de la population ont accepté des mesures strictes sans chercher à en évaluer de manière critique la proportionnalité.
- Biais de confirmation : Les médias et les réseaux sociaux ont pu jouer un rôle en diffusant des informations qui confortaient les croyances préexistantes, renforçant ainsi le récit sacrificiel et le besoin de contrôle.
2.6.2 Biais de cadrage et effet de la rhétorique de peur
- La manière dont la crise a été présentée a cadré l’ensemble du débat public : en insistant sur le risque, la menace imminente et la nécessité de mesures radicales, le discours médiatique a contribué à une vision alarmiste qui justifiait des restrictions drastiques.
- Ce cadrage a également nourri l’idée d’un « sacrifice nécessaire » en masquant des alternatives potentielles, comme des mesures plus ciblées ou un soutien accru aux populations vulnérables.
2.6.3 Rôle des réseaux sociaux et de la polarisation
- Les réseaux sociaux ont joué un rôle ambivalent en amplifiant à la fois le récit officiel et ses contre-récits. Cette polarisation a rendu difficile une approche nuancée des problématiques, accentuant le sentiment de division et de sacrifice imposé.
- Cette polarisation a également alimenté des narrations concurrentes qui, parfois, détournaient l’attention des véritables enjeux (par exemple, en se concentrant uniquement sur la dimension économique au détriment des conséquences psychologiques).
2.6.4 Biais d’omission et invisibilisation des souffrances
- Un biais d’omission semble présent dans la manière dont certains impacts ont été minimisés, notamment les conséquences sur la santé mentale des jeunes ou les souffrances vécues dans les EHPAD.
- Reconnaître ces angles morts pourrait enrichir l’analyse en montrant que le récit officiel a souvent occulté des aspects essentiels de la réalité vécue par une partie de la population.
2.7 Perspective historique et comparaisons inter-crises
2.7.1 Pandémie de grippe espagnole (1918-1919)
- Contexte et mesures : La grippe espagnole a causé des millions de décès dans un contexte de Première Guerre mondiale et de capacités médicales limitées. Les mesures de confinement étaient parfois localisées et improvisées, sans véritable plan global.
- Narratif du sacrifice : Bien que la notion de sacrifice n’ait pas été formulée de façon aussi systématique qu’aujourd’hui, l’extrême violence de la pandémie a engendré un climat de peur et de résignation qui a marqué l’inconscient collectif.
2.7.2 Crises sanitaires récentes (SARS 2003, H1N1 2009, MERS 2012)
- Approches ciblées vs. mesures globales : Contrairement à la Covid-19, ces épidémies, bien que graves, ont souvent concerné des zones géographiques limitées ou des populations spécifiques, permettant des interventions plus ciblées.
- Impact médiatique et perception du risque : La couverture médiatique et la rapidité de la diffusion de l’information étaient moins exacerbées, ce qui a conduit à une mobilisation moins généralisée autour du concept de « sacrifice » collectif.
2.7.3 L’évolution de la communication et le rôle des réseaux sociaux
- Amplification de la peur : Avec l’avènement d’internet et des réseaux sociaux, la diffusion d’informations (et de désinformations) a permis un cadrage du discours de manière beaucoup plus immédiate et globale.
- Narratif sacrificiel renforcé : Les injonctions à la solidarité et au sacrifice ont pu être amplifiées par ces canaux, créant une atmosphère où le débat était rapidement polarisé et où la responsabilité individuelle était souvent réduite à une simple obligation morale.
2.7.4 Comparaison avec d’autres crises socio-économiques
- Crise financière de 2008 : On peut comparer la gestion de la pandémie à celle d’autres crises majeures, où la réponse politique et la communication ont également révélé des biais – par exemple, en privilégiant certains groupes économiques au détriment d’autres.
- Réaction collective face à l’incertitude : Dans les deux cas, l’usage d’un discours rassurant et paternaliste a servi à canaliser l’angoisse collective, parfois au prix d’une inversion des priorités (protéger les actifs ou les puissants plutôt que de soutenir les plus vulnérables).
Ces comparaisons permettent de mettre en relief le caractère unique de la réponse à la Covid-19, tout en soulignant que les mécanismes de peur, de sacrifice et de déni ne sont pas nouveaux, mais qu’ils se sont adaptés aux évolutions technologiques et culturelles. Elles offrent ainsi un cadre pour comprendre comment, dans différents contextes historiques, le besoin de sécuriser et de contrôler la société peut conduire à des mesures qui, bien qu’imposées au nom du « bien commun », révèlent souvent des dynamiques de pouvoir et des biais inconscients similaires.
2.7.5 Quand le clivage alimente le contrôle renforcé : une analyse de la crise
- Le clivage familial : une fracture intime exacerbée par la crise.
Au-delà des divisions sociales et politiques, la pandémie de Covid-19 a profondément marqué la sphère familiale. Les divergences d’opinions et de comportements face aux mesures sanitaires – que ce soit sur le port du masque, le confinement ou la vaccination – se sont transformées en véritables marqueurs identitaires au sein même des foyers.
Les discussions, souvent passionnées, ont creusé des fossés entre générations, entre parents et enfants, et même entre frères et sœurs, transformant des liens affectifs en points de tension. Ce clivage familial illustre la manière dont le discours clivant et moralisateur, véhiculé à grande échelle, s’est infiltré dans l’intime, engendrant des blessures psychologiques durables.
Pour comprendre l’impact global de la crise, il est crucial de reconnaître que ces divisions ne relèvent pas seulement d’une polarisation de la société, mais également d’une fracture intime qui a altéré la confiance et la cohésion au sein des familles.
Ce constat souligne l’importance de repenser les stratégies de communication et d’accompagnement, afin de réparer ces cicatrices et de favoriser un dialogue qui transcende les clivages.
2.8 Vers un rééquilibrage : reconnaître les angles morts
Pour sortir de ce schéma, il conviendrait de :
- Prendre conscience du déni de la génération au pouvoir
Il est nécessaire de reconnaître que beaucoup de responsables ont agi sous l’emprise de peurs non résolues (voir article sur le déni), et non d’un strict calcul rationnel.
- Démanteler la rhétorique sacrificielle
Plutôt que de présenter l’engagement de chacun comme un acte de culpabilisation ou de soumission, il faudrait valoriser la diversité des solutions (prévention ciblée, soutien psychologique, économie solidaire) sans s’en remettre à la seule coercition.
- Rétablir une hiérarchie des valeurs plus juste
Protéger les aînés actifs est légitime, mais pas au prix d’un aveuglement sur la souffrance des jeunes et des plus démunis, des plus agés inactifs. Reconnaître la nécessité de préserver le futur est un impératif moral autant que pragmatique.
Reconnaître la nécessité de préserver le futur en tant qu’impératif moral et pragmatique revient à promouvoir des décisions réfléchies, fondées sur une vision à long terme, et non sur la peur ou des réactions impulsives. Cela contraste nettement avec les décisions irrationnelles qui ont parfois été observées, où la peur et des biais cognitifs ont conduit à des mesures disproportionnées ou contre-productives, mettant en péril non seulement certaines populations, mais aussi l’équilibre social et économique global. Autrement dit, il s’agit d’une invitation à adopter des stratégies qui allient éthique et efficacité, afin de garantir un avenir viable pour tous.
- Accepter de voir les dégâts
Un débat sincère sur les conséquences économiques, mentales et sociales est indispensable. Il exige de dépasser le déni et d’assumer les choix politiques faits pendant la crise, y compris leurs errements.
3 Conclusion
La pandémie de Covid-19 a révélé, derrière le discours officiel de solidarité et de protection, un enchevêtrement de peurs générationnelles, de schémas religieux de sacrifice et d’une inversion des valeurs qui a sacrifié les plus fragiles, souvent les plus jeunes, au bénéfice d’une frange active plus âgée et socialement puissante. Un déni partiel des conséquences semble avoir persisté, sans doute parce qu’il est difficile d’admettre avoir infligé des torts à ceux qui méritaient au contraire la plus grande protection.
Comprendre ces facteurs – héritage historique, inconscient religieux, inversion des valeurs et déni – aide à prendre du recul sur les décisions qui ont marqué la période pandémique. C’est aussi un préalable pour imaginer, à l’avenir, des politiques sanitaires et sociales plus équilibrées, qui ne reposent pas sur la culpabilisation ou le sacrifice d’une catégorie au profit d’une autre, mais sur une véritable prise en compte de l’ensemble des fragilités humaines.

Laisser un commentaire